Recherche et collaboration

La science de la biodiversité
Les approches traditionnelles ne sauraient être suffisantes pour endiguer et résoudre la crise de la biodiversité. Puisque le changement de biodiversité émane de l’influence grandissante des humains sur leur environnement, il faut combiner à la fois des recherches en sciences naturelles et en sciences sociales. Les sciences de la biodiversité sont donc un domaine multidisciplinaire utilisant des outils et des théories issues de différentes matières comme la biologie moléculaire, la taxonomie, la génétique, le savoir traditionnel, les sciences politiques, l’éco-informatique, l’économie et l’écologie.
Axes de recherche
Collaborations scientifiques
Entraîner la prochaine génération
savoir à l’action
Vitrine sur la recherche au CSBQ
IPBES
Évaluation méthodologique du suivi de la biodiversité et des contributions de la nature aux populations
 La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) est un organisme intergouvernemental indépendant créé pour renforcer l'interface science-politique pour la biodiversité et les services écosystémiques pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, le bien-être humain à long terme et le développement durable.
La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) est un organisme intergouvernemental indépendant créé pour renforcer l'interface science-politique pour la biodiversité et les services écosystémiques pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, le bien-être humain à long terme et le développement durable.
Dans la décision IPBES-10/1, la Plénière a approuvé une évaluation méthodologique sur le suivi de la biodiversité et des contributions de la nature aux populations. À la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, l'Université McGill a proposé d'héberger l'unité de soutien technique pour l'évaluation, qui a été acceptée par le Bureau le 22 novembre 2023.
L'évaluation vise à soutenir les efforts nationaux et mondiaux pour :
(a) surveiller la biodiversité, les contributions de la nature aux populations et les facteurs des changements observés ; et
(b) suivre les progrès vers les objectifs et les cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (GBF), à l'appui de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et de ses trois objectifs, tout en contribuant au suivi des Objectifs de développement durable et d'autres accords multilatéraux sur l'environnement pertinents. L'évaluation évaluera les données et systèmes existants, ainsi que ceux nécessaires au calcul des indicateurs du cadre de suivi du GBF, en priorisant les indicateurs principaux et en évaluant la disponibilité des données pour les autres. Elle examinera les capacités et les ressources existantes pour la collecte et l'analyse des données aux échelles nationale et mondiale, en identifiant les lacunes dans la disponibilité et l'accès aux données, y compris les biais dans la couverture taxonomique, géographique et temporelle des écosystèmes marins, des eaux intérieures et terrestres. Les défis et les obstacles liés à la production, à l'accès et au partage des données, ainsi qu'à l'application de méthodes statistiques robustes pour la détection et l'attribution des tendances, seront également évalués.
Enfin, l'évaluation mettra en évidence les possibilités de renforcer les capacités de suivi, en particulier dans les pays en développement. Elle évaluera également les possibilités de faire progresser le suivi communautaire, autochtone et citoyen, et envisagera des options pour améliorer la coopération, promouvoir le partage des ressources et la communication de l'information, et faciliter l'intégration de données provenant de sources multiples, dans le but d'améliorer la compréhension de l'évolution de la biodiversité, en particulier dans les régions sous-représentées.
Pour plus d'informations, contactez nous :
Funding source: IPBES, Université McGill (département de biologie)
Andrew Gonzalez, Fanie Pelletier
Biodiversité Québec
Colliger les données d’observation, améliorer le suivi de la biodiversité au Québec et rendre accessibles des synthèses et des analyses au public
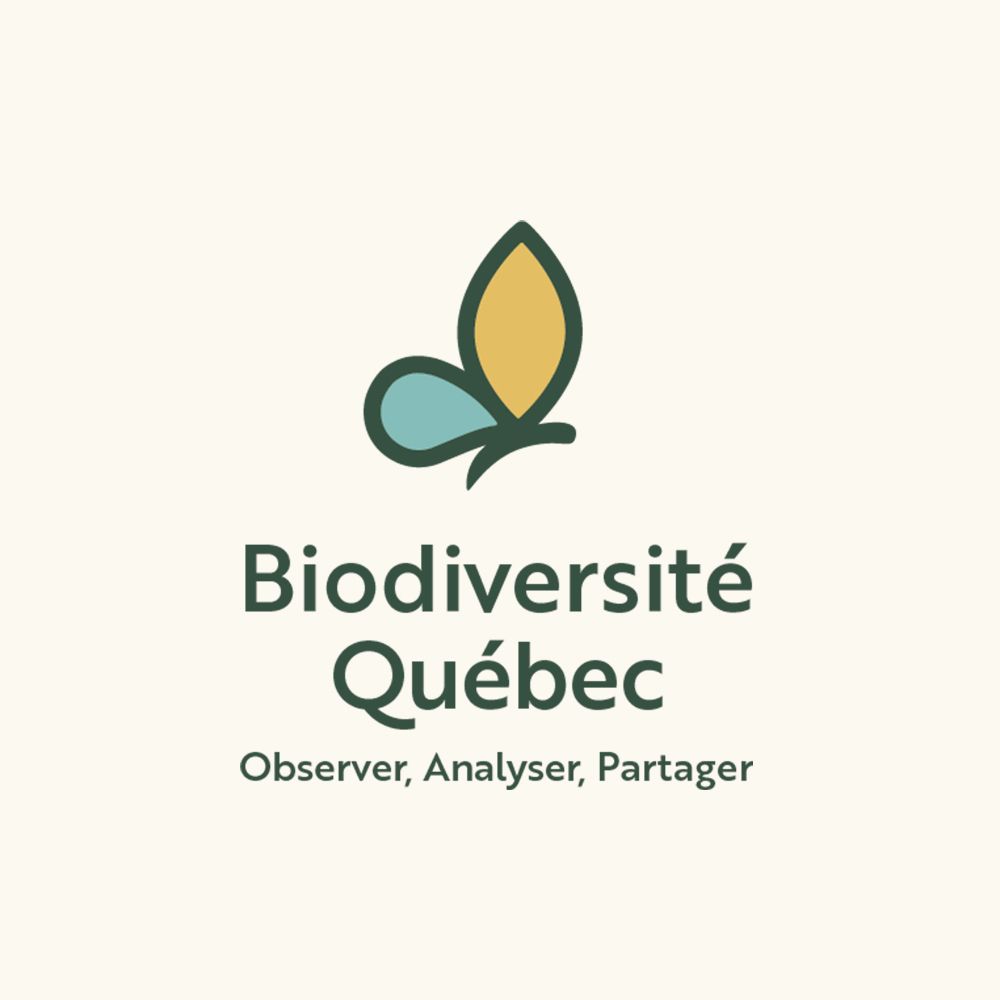 Biodiversité Québec est un partenariat scientifique dont le travail vise notamment à la communication d’informations sur l’état de la biodiversité et de ses changements. Il souhaite devenir un agent incontournable pour observer les changements qui s’opèrent dans les écosystèmes, en plus de diffuser de l’information vulgarisée. Sa mission est de colliger les données d’observation, d‘améliorer le suivi de la biodiversité au Québec et de rendre accessibles des synthèses et des analyses au public. L’initiative a aussi comme mission de sensibiliser les Québécois et Québécoises aux enjeux de la biodiversité, en plus de soutenir les décideurs et décideuses et les gestionnaires de territoire dans la prise en compte des données de biodiversité. Le gouvernement du Québec et des chercheurs universitaires rassemblent de nombreux partenaires au sein d’un même réseau. Biodiversité Québec mise sur un effort collectif pour l’acquisition des connaissances sur le terrain, la valorisation des données et l'utilisation de nouvelles technologies. La mise en commun des données recueillies permet de réaliser de nouvelles avancées scientifiques afin d'anticiper les effets du climat et des activités humaines sur les écosystèmes.
Biodiversité Québec est un partenariat scientifique dont le travail vise notamment à la communication d’informations sur l’état de la biodiversité et de ses changements. Il souhaite devenir un agent incontournable pour observer les changements qui s’opèrent dans les écosystèmes, en plus de diffuser de l’information vulgarisée. Sa mission est de colliger les données d’observation, d‘améliorer le suivi de la biodiversité au Québec et de rendre accessibles des synthèses et des analyses au public. L’initiative a aussi comme mission de sensibiliser les Québécois et Québécoises aux enjeux de la biodiversité, en plus de soutenir les décideurs et décideuses et les gestionnaires de territoire dans la prise en compte des données de biodiversité. Le gouvernement du Québec et des chercheurs universitaires rassemblent de nombreux partenaires au sein d’un même réseau. Biodiversité Québec mise sur un effort collectif pour l’acquisition des connaissances sur le terrain, la valorisation des données et l'utilisation de nouvelles technologies. La mise en commun des données recueillies permet de réaliser de nouvelles avancées scientifiques afin d'anticiper les effets du climat et des activités humaines sur les écosystèmes.
Pour plus d'informations, contactez-nous :
Funding source: CSRNG Alliance, avec les contributions de: MELCCFP, Fondaction, ECCC, Insectarium de Montréal, Wildlife Conservation Society, Conservation de la Nature Canada, SNAP Québec.
Guillaume Blanchet, Dominique Gravel, Laura Pollock, Coralie Beaumont, Vincent Beauregard, William Cabrera, Victor Cameron, Vanessa Di Maurizio, Samuel Enright, Kim Gauthier-Schampaert, Claire-Cécile Juhasz, Kaesha Maheu-Raymond, Benjamin Mercier, El-Amine Mimouni, François Rousseu, Marie-Pierre Varin
BON in a Box
Réseaux d'observation de biodiversité pour la surveillance de la biodiversité et la prise de décisions en matière de conservation

Pour plus d'informations, contactez nous :
Funding source: Microsoft, CSBQ
Guillaume Blanchet, Andrew Gonzalez, Dominique Gravel, Brian Leung, Pedro Peres-Neto, Timothée Poisot, Laura Pollock, María Isabel Arce Plata, Michael Catchen, Jory Griffith, Jean-Michel Lord, Victor Rincon Parra, Juan Zuloaga
Blitz the Gap: Échantillonnage guidé de la biodiversité au Québec
Le projet « Blitz the Gap » vise à tirer parti du vaste réseau du CSBQ pour combler les lacunes en matière de données sur la biodiversité.
 Le Québec est vaste et sous-échantillonné : plus de 90 % de son territoire est dépourvu de toute trace d’occurrence d’aucun taxon. Combler ces lacunes par des relevés scientifiques et de gestion traditionnels serait extrêmement long et coûteux. La science citoyenne est la seule voie viable pour les combler rapidement. Cependant, elle privilégie certains taxons et certains lieux, laissant d’importantes lacunes qui nécessitent une coordination. Le CSBQ est bien placé pour contribuer à combler cette lacune, car il s’agit d’un réseau d’universités et de chercheurs qui vivent, travaillent et étudient dans de nombreux endroits du Québec. Le projet « Blitz the Gap » (www.blitzthegap.org) vise à tirer parti du vaste réseau du CSBQ pour combler les lacunes en matière de données sur la biodiversité. Le principal volet de financement est constitué de bourses Champion, offertes aux étudiants diplômés et aux membres postdoctoraux du CSBQ pour planifier un bioblitz avec une communauté locale, un parc, une bibliothèque ou une école, ou pour financer des activités d’échantillonnage pour eux-mêmes et leur groupe de laboratoire. Ces subventions offrent aux membres du CSBQ des occasions de leadership et de développement pour mener leurs propres initiatives visant à combler les lacunes en matière de données qui limitent notre capacité à surveiller la biodiversité au Québec et à resserrer les liens entre le CSBQ et les communautés locales. Nous avons collaboré avec James Pagé d'iNaturalist Canada pour nous conseiller sur ce projet. Toutes les observations sont recueillies dans le cadre du projet « Blitz the Gap » sur iNaturalist.ca (avec un projet spécifique pour les membres du CSBQ : inaturalist.ca/projects/blitz-the-gap-qcbs-champions) et seront incluses dans la base de données de l'Atlas de Biodiversité Québec pour surveiller l'évolution de la biodiversité au Québec. La prochaine version comprendra des « défis » automatisés (p. ex., cartes prioritaires et listes d'espèces). Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de créer un projet « Bon-in-a-Box » accessible au public, qui permettra aux scientifiques et aux conservationnistes de changer de scénario pour élaborer un plan d'échantillonnage personnalisé (p. ex., améliorer la couverture de l'aire de répartition des espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes) et offrira un accès transparent à l'ensemble du pipeline.
Le Québec est vaste et sous-échantillonné : plus de 90 % de son territoire est dépourvu de toute trace d’occurrence d’aucun taxon. Combler ces lacunes par des relevés scientifiques et de gestion traditionnels serait extrêmement long et coûteux. La science citoyenne est la seule voie viable pour les combler rapidement. Cependant, elle privilégie certains taxons et certains lieux, laissant d’importantes lacunes qui nécessitent une coordination. Le CSBQ est bien placé pour contribuer à combler cette lacune, car il s’agit d’un réseau d’universités et de chercheurs qui vivent, travaillent et étudient dans de nombreux endroits du Québec. Le projet « Blitz the Gap » (www.blitzthegap.org) vise à tirer parti du vaste réseau du CSBQ pour combler les lacunes en matière de données sur la biodiversité. Le principal volet de financement est constitué de bourses Champion, offertes aux étudiants diplômés et aux membres postdoctoraux du CSBQ pour planifier un bioblitz avec une communauté locale, un parc, une bibliothèque ou une école, ou pour financer des activités d’échantillonnage pour eux-mêmes et leur groupe de laboratoire. Ces subventions offrent aux membres du CSBQ des occasions de leadership et de développement pour mener leurs propres initiatives visant à combler les lacunes en matière de données qui limitent notre capacité à surveiller la biodiversité au Québec et à resserrer les liens entre le CSBQ et les communautés locales. Nous avons collaboré avec James Pagé d'iNaturalist Canada pour nous conseiller sur ce projet. Toutes les observations sont recueillies dans le cadre du projet « Blitz the Gap » sur iNaturalist.ca (avec un projet spécifique pour les membres du CSBQ : inaturalist.ca/projects/blitz-the-gap-qcbs-champions) et seront incluses dans la base de données de l'Atlas de Biodiversité Québec pour surveiller l'évolution de la biodiversité au Québec. La prochaine version comprendra des « défis » automatisés (p. ex., cartes prioritaires et listes d'espèces). Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de créer un projet « Bon-in-a-Box » accessible au public, qui permettra aux scientifiques et aux conservationnistes de changer de scénario pour élaborer un plan d'échantillonnage personnalisé (p. ex., améliorer la couverture de l'aire de répartition des espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes) et offrira un accès transparent à l'ensemble du pipeline.
Pour plus d'informations, contactez nous :
Funding source: CSBQ, Institut canadien d'écologie et d'évolution - Projet Living Data, Environnement et Changement climatique Canada, CRSNG
Guillaume Blanchet, Dominique Gravel, Katherine Hébert, Abbie Jones
L’impact de l’économie circulaire sur la biodiversité: vers une approche intégrée pour soutenir la prise de décisions
Développer un cadre conceptuel et opérationnel, des indicateurs et des outils concrets pour évaluer l’impact des stratégies de circularité sur la biodiversité, et inversement.
 Ce projet de recherche transdisciplinaire vise à renforcer la compréhension et l’intégration des liens entre économie circulaire (ÉC) et biodiversité, afin de soutenir la prise de décision publique et sectorielle en lien avec les cibles du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal et le Plan Nature 2030 du Québec. L’objectif est de développer un cadre conceptuel et opérationnel, des indicateurs et des outils concrets pour évaluer l’impact des stratégies de circularité sur la biodiversité, et inversement. Le projet est porté par un groupe de partenaires académiques et communautaires reconnus, qui rassemblent des expertises en économie circulaire, en science de la biodiversité et en conservation:
Ce projet de recherche transdisciplinaire vise à renforcer la compréhension et l’intégration des liens entre économie circulaire (ÉC) et biodiversité, afin de soutenir la prise de décision publique et sectorielle en lien avec les cibles du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal et le Plan Nature 2030 du Québec. L’objectif est de développer un cadre conceptuel et opérationnel, des indicateurs et des outils concrets pour évaluer l’impact des stratégies de circularité sur la biodiversité, et inversement. Le projet est porté par un groupe de partenaires académiques et communautaires reconnus, qui rassemblent des expertises en économie circulaire, en science de la biodiversité et en conservation:
Réseau de recherche en économie circulaire du Québec (RRECQ): Réseau unique au Canada, mobilisant plus de 230 chercheuses et chercheurs pour renforcer la capacité à déployer des stratégies de circularité à l’échelle des secteurs industriels et des territoires, dans une perspective de transition soutenable.
Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ): Réseau interinstitutionnel reconnu qui contribue à positionner le Québec comme un chef de file en science de la biodiversité. Il mobilise une large communauté de chercheurs autour du suivi des écosystèmes, de la prévision des changements de biodiversité et de l’appui à la prise de décision, en s’appuyant sur une diversité d’approches allant des technologies d’observation aux sciences sociales.
Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec): Organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature. Reconnue pour son approche collaborative avec les gouvernements, les Premières Nations, les Inuits, les acteurs de l’industrie et les communautés locales.
Biodiversité Québec: Initiative soutenue par le gouvernement et la communauté scientifique. Vise à colliger et valoriser les données d’observation de la biodiversité, et à produire des synthèses et outils accessibles pour les décideurs et gestionnaires de territoire. En croisant ces expertises, le projet ambitionne de faire émerger des approches intégrées et territorialisées, à partir d’ateliers, de revues de littérature et d’études de cas concrets, afin d’outiller les décideurs et d’accélérer les transitions écologiques porteuses de bénéfices pour la nature et la société.
Pour plus d'information, contactez nous :
Funding source: MELCCFP, FRQ
Dominique Gravel, Fanie Pelletier, Rim Khlifa
Adaptation aux changements climatiques
 En 2009, sous l’impulsion de la fondation Prince Albert II de Monaco, le gouvernement du Québec et le Consortium Ouranos lancent un projet d’Atlas de la biodiversité du Québec nordique. Ce projet vise à développer un outil d’intégration des connaissances de la biodiversité du Québec nordique qui prenne en considération les impacts des changements climatiques.
En 2009, sous l’impulsion de la fondation Prince Albert II de Monaco, le gouvernement du Québec et le Consortium Ouranos lancent un projet d’Atlas de la biodiversité du Québec nordique. Ce projet vise à développer un outil d’intégration des connaissances de la biodiversité du Québec nordique qui prenne en considération les impacts des changements climatiques.
Sophie Calmé, Andrew Gonzalez, Fanie Pelletier
Bilan de la biodiversité et des Entreprises du Québec (BBEQ)
Le but de cette initiative est de créer les conditions nécessaires pour identifier, tester, adapter et disséminer un ensemble d’outils qui vont promouvoir et faciliter l’intégration des questions de biodiversité dans les opérations quotidiennes des entreprises.
 De nouvelles initiatives sont nécessaires pour renverser les tendances observées de perte de la biodiversité, en particulier, des stratégies qui vont permettre la prise en compte de ce problème global au travers d’actions locales et régionales. Une des approches privilégiées reconnaît le rôle que jouent le milieu des affaires et plus globalement l’économie dans les changements de la biodiversité. Au Québec, on constate un besoin croissant de dialogue entre les parties prenantes afin de permettre au milieu des affaires de s’impliquer et d’intégrer les questions de biodiversité dans les stratégies corporatives et pratiques des entreprises. Afin de répondre à ces besoins, le Centre de la Science de la Biodiversité du Québec et ses partenaires ont lancé une initiative commune : le Projet de Bilan de la biodiversité et des Entreprises du Québec (PBBEQ).
De nouvelles initiatives sont nécessaires pour renverser les tendances observées de perte de la biodiversité, en particulier, des stratégies qui vont permettre la prise en compte de ce problème global au travers d’actions locales et régionales. Une des approches privilégiées reconnaît le rôle que jouent le milieu des affaires et plus globalement l’économie dans les changements de la biodiversité. Au Québec, on constate un besoin croissant de dialogue entre les parties prenantes afin de permettre au milieu des affaires de s’impliquer et d’intégrer les questions de biodiversité dans les stratégies corporatives et pratiques des entreprises. Afin de répondre à ces besoins, le Centre de la Science de la Biodiversité du Québec et ses partenaires ont lancé une initiative commune : le Projet de Bilan de la biodiversité et des Entreprises du Québec (PBBEQ).
Jérôme Dupras, Andrew Gonzalez
Bio-Bridge
L'objectif de l'initiative du Bio-Bridge est de promouvoir et faciliter la cooperation technique et scientifique.
 Le CSBQ en partenariat avec le World Conservation Monitoring Centre ( WCMC ) ont été choisis pour devenir le partenaire externe au secrétariat de la CDB pour la mise en œuvre de l’initiative Bio-Bridge. Cette initiative de la République de Corée pour aider les Parties à la CDB afin de mettre en œuvre l’ensemble des décisions adoptées à la CdP 12 qui forment ensemble la Feuille de route adoptée a Pyeongchang pour l’amélioration de la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité ainsi que la réalisation des objectifs d’Aichi et de soutenir la réalisation de la cible d’Aichi 19 sur la coopération technique et scientifique.
Le CSBQ en partenariat avec le World Conservation Monitoring Centre ( WCMC ) ont été choisis pour devenir le partenaire externe au secrétariat de la CDB pour la mise en œuvre de l’initiative Bio-Bridge. Cette initiative de la République de Corée pour aider les Parties à la CDB afin de mettre en œuvre l’ensemble des décisions adoptées à la CdP 12 qui forment ensemble la Feuille de route adoptée a Pyeongchang pour l’amélioration de la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité ainsi que la réalisation des objectifs d’Aichi et de soutenir la réalisation de la cible d’Aichi 19 sur la coopération technique et scientifique.
BIOS2
Une communauté de jeunes chercheurs qui explorent et appliquent des méthodes informatiques et quantitatives de pointe afin de relever les défis des sciences de la biodiversité.
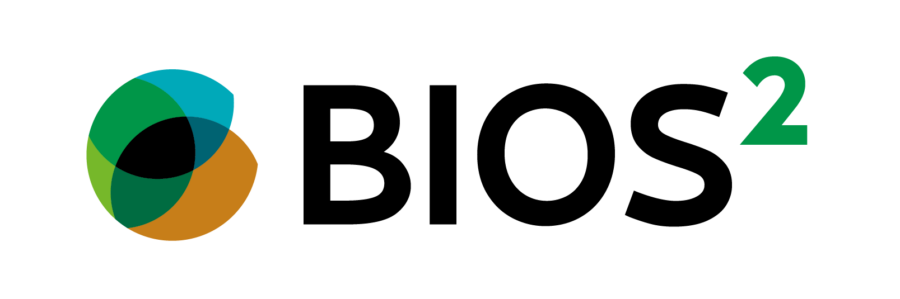 La science de la biodiversité a évolué au cours des quinze dernières années grâce à des progrès techniques remarquables en matière de puissance de calcul et de disponibilité des données. Les programmes de surveillance de la biodiversité, ainsi que les projets de recherche et la science citoyenne génèrent des quantités massives d’informations qui peuvent être utilisées pour prédire les futurs impacts des activités humaines sur la biodiversité. D’autres domaines des sciences de la vie, comme la génomique, la médecine et les neurosciences, ont relevé le défi des données massives en développant des infrastructures de calcul, des pipelines de données et des cadres analytiques, alors que l’écologie est comparativement en retard. Il est donc nécessaire d’adopter une approche spécifique pour améliorer les connaissances informatiques de la future génération d’écologistes. Le programme de formation en méthodes numériques appliquées à la science de la biodiversité (BIOS2) a été développé pour répondre à ce besoin.
BIOS2 est une communauté de jeunes chercheurs qui explorent et appliquent des méthodes informatiques et quantitatives de pointe afin de relever les défis des sciences de la biodiversité. À travers des formations techniques et transversales, des groupes de travail, des stages et des activités de collaboration et de réseautage, le programme vise à élargir les perspectives et les compétences des étudiant.e.s et stagiaires postdoctoraux, et à les préparer à une carrière à fort impact en science de la biodiversité.
Pour questions : info.bio2@usherbrooke.ca
La science de la biodiversité a évolué au cours des quinze dernières années grâce à des progrès techniques remarquables en matière de puissance de calcul et de disponibilité des données. Les programmes de surveillance de la biodiversité, ainsi que les projets de recherche et la science citoyenne génèrent des quantités massives d’informations qui peuvent être utilisées pour prédire les futurs impacts des activités humaines sur la biodiversité. D’autres domaines des sciences de la vie, comme la génomique, la médecine et les neurosciences, ont relevé le défi des données massives en développant des infrastructures de calcul, des pipelines de données et des cadres analytiques, alors que l’écologie est comparativement en retard. Il est donc nécessaire d’adopter une approche spécifique pour améliorer les connaissances informatiques de la future génération d’écologistes. Le programme de formation en méthodes numériques appliquées à la science de la biodiversité (BIOS2) a été développé pour répondre à ce besoin.
BIOS2 est une communauté de jeunes chercheurs qui explorent et appliquent des méthodes informatiques et quantitatives de pointe afin de relever les défis des sciences de la biodiversité. À travers des formations techniques et transversales, des groupes de travail, des stages et des activités de collaboration et de réseautage, le programme vise à élargir les perspectives et les compétences des étudiant.e.s et stagiaires postdoctoraux, et à les préparer à une carrière à fort impact en science de la biodiversité.
Pour questions : info.bio2@usherbrooke.ca
Funding source: Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche (FONCER) du CRSNG.
Joël Bêty, Anne Bruneau, Andrew Gonzalez, Steven Kembel, Sarah Otto, Pedro Peres-Neto, Timothée Poisot, Andrew MacDonald
Le réseau ResNet
Fournir les connaissances et les informations intersectorielles nécessaires à la gestion des paysages fonctionnels.
 Dans les paysages fonctionnels, l'accent a été mis sur la production bon marché, fiable et efficace des services écosystémiques individuelles telles que la nourriture, l'énergie ou le bois, ignorant la plupart des effets sur d'autres services ou d'autres endroits. Nous prenons des décisions de cette manière même si nous avons de bonnes preuves qu'il existe des interactions entre les secteurs de ressources naturelles, entre les régions et entre les services écosystémiques. Ceci mène à des décisions de grande importance concernant l'avenir prises de façon isolée et fragmentaire avec une image limitée des risques écologiques, économiques et sociaux associés à ces décisions. ResNet (2019 – 2024) est conçu pour fournir les connaissances et les informations intersectorielles nécessaires à la gestion des paysages fonctionnels afin d'assurer la fourniture de multiples services écosystémiques pour de multiples bénéficiaires, maintenant et à l'avenir. Pour y arriver, ResNet concentre ses travaux sur trois principaux thèmes pour lesquels les études sont peu nombreuses, dans six paysages fonctionnels du Canada. Dans chacun des six paysages, le réseau ResNet a lancé une série d’études sur la production, la modélisation et la gouvernance de services écosystémiques multiples, conçues en collaboration par des universitaires, le secteur privé, les administrations publiques, les ONG, les partenaires autochtones et d’autres intervenants. Le réseau ResNet est un groupe interdisciplinaire de chercheurs (100+ chercheurs, 11 universités, 17 organisations partenaires), notamment des chercheurs reconnus internationalement pour leur expertise en écologie, en économie, en gestion des ressources naturelles, en gestion socioécologique, en résilience des systèmes, en statistiques et en modélisation. Finalement, le réseau ResNet mettra au point de nouveaux outils permettant d’estimer les effets des décisions en matière de gestion et d’utilisation des terres sur les services écosystémiques multiples des paysages fonctionnels du Canada. Ces outils pourront améliorer l’intendance des paysages fonctionnels du Canada et de tous les services écosystémiques qu’ils fournissent, tout en faisant avancer les connaissances scientifiques fondamentales sur ces services écosystémiques.
Dans les paysages fonctionnels, l'accent a été mis sur la production bon marché, fiable et efficace des services écosystémiques individuelles telles que la nourriture, l'énergie ou le bois, ignorant la plupart des effets sur d'autres services ou d'autres endroits. Nous prenons des décisions de cette manière même si nous avons de bonnes preuves qu'il existe des interactions entre les secteurs de ressources naturelles, entre les régions et entre les services écosystémiques. Ceci mène à des décisions de grande importance concernant l'avenir prises de façon isolée et fragmentaire avec une image limitée des risques écologiques, économiques et sociaux associés à ces décisions. ResNet (2019 – 2024) est conçu pour fournir les connaissances et les informations intersectorielles nécessaires à la gestion des paysages fonctionnels afin d'assurer la fourniture de multiples services écosystémiques pour de multiples bénéficiaires, maintenant et à l'avenir. Pour y arriver, ResNet concentre ses travaux sur trois principaux thèmes pour lesquels les études sont peu nombreuses, dans six paysages fonctionnels du Canada. Dans chacun des six paysages, le réseau ResNet a lancé une série d’études sur la production, la modélisation et la gouvernance de services écosystémiques multiples, conçues en collaboration par des universitaires, le secteur privé, les administrations publiques, les ONG, les partenaires autochtones et d’autres intervenants. Le réseau ResNet est un groupe interdisciplinaire de chercheurs (100+ chercheurs, 11 universités, 17 organisations partenaires), notamment des chercheurs reconnus internationalement pour leur expertise en écologie, en économie, en gestion des ressources naturelles, en gestion socioécologique, en résilience des systèmes, en statistiques et en modélisation. Finalement, le réseau ResNet mettra au point de nouveaux outils permettant d’estimer les effets des décisions en matière de gestion et d’utilisation des terres sur les services écosystémiques multiples des paysages fonctionnels du Canada. Ces outils pourront améliorer l’intendance des paysages fonctionnels du Canada et de tous les services écosystémiques qu’ils fournissent, tout en faisant avancer les connaissances scientifiques fondamentales sur ces services écosystémiques.
Funding source: CRSNG
Elena Bennett, Jérôme Dupras, Andrew Gonzalez, Dominique Gravel, Gordon Hickey, Murray Humphries, Etienne Laliberté, Stéphanie Pellerin, Monique Poulin
La Science de la connectivité écologique dans l'est du Canada et la Nouvelle-Angleterre
Une évaluation de la science et des projets décrivant les paysages connectés de la région
 Le rapport sur la science de la connectivité écologique dans la Région de la Résolution 40-3 passe en revue la science de la connectivité et l'ensemble des plans et projets axés sur l'évaluation et la protection de la connectivité écologique de la région nord-est de l’Amérique du Nord.
Ces projets sont désormais répertoriés sur le portail Web de la connectivité écologique (https://connectiviteecologique.com). Les objectifs et la portée géographique de ces projets sont comparés, tout en contrastant les méthodes et mesures scientifiques utilisées pour définir les réseaux d'habitats et de corridors qu'ils identifient. Ces méthodes sont comparées aux approches actuelles de la littérature scientifique sur la connectivité et les possibilités d'intégrer les informations et les objectifs de conservation dans les plans sont identifiées. Pour faciliter l'interprétation, un bref examen des concepts clés de la recherche sur la connectivité est fourni. En comparant les méthodologies, les échelles et la couverture de ces projets, les auteurs de ce rapport identifient les lacunes actuelles des analyses, mais aussi les possibilités d'exploiter la science de la connectivité pour la conservation dans la région.
Le rapport sur la science de la connectivité écologique dans la Région de la Résolution 40-3 passe en revue la science de la connectivité et l'ensemble des plans et projets axés sur l'évaluation et la protection de la connectivité écologique de la région nord-est de l’Amérique du Nord.
Ces projets sont désormais répertoriés sur le portail Web de la connectivité écologique (https://connectiviteecologique.com). Les objectifs et la portée géographique de ces projets sont comparés, tout en contrastant les méthodes et mesures scientifiques utilisées pour définir les réseaux d'habitats et de corridors qu'ils identifient. Ces méthodes sont comparées aux approches actuelles de la littérature scientifique sur la connectivité et les possibilités d'intégrer les informations et les objectifs de conservation dans les plans sont identifiées. Pour faciliter l'interprétation, un bref examen des concepts clés de la recherche sur la connectivité est fourni. En comparant les méthodologies, les échelles et la couverture de ces projets, les auteurs de ce rapport identifient les lacunes actuelles des analyses, mais aussi les possibilités d'exploiter la science de la connectivité pour la conservation dans la région.
Funding source: Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Andrew Gonzalez, Alexandre Arkilanian, Valentin Lucet
Un Plan Sud pour le Québec
Protéger notre patrimoine naturel et s'adapter aux changements globaux
 Depuis des décennies, le Québec méridional subit des pressions de développement importantes et soutenues, et fait face à de forts arbitrages pour l’utilisation du territoire et des ressources qu’il contient sur un modèle économique de type extractif qui évolue peu. Pourtant, la biodiversité du Québec est principalement concentrée dans cette partie de la province, plus diversifiée que les zones plus au nord. Ces pressions affectent la biodiversité et induisent de profonds changements dans les fonctions et les services
rendus par les écosystèmes dont dépendent de nombreux secteurs économiques, et plus globalement, notre bien-être.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que la biodiversité est généralement reconnue comme la base de toute stratégie d’adaptation face aux changements climatiques. Pour que la société québécoise puisse faire face aux changements environnementaux, qu’ils soient locaux ou plus globaux, il est nécessaire de développer une autre relation à notre patrimoine naturel, en particulier au sud du 49e parallèle du Québec.
La demande sociale grandissante pour la protection de l’environnement témoigne de l’importance de ces enjeux pour de nombreuses parties prenantes, et il se dégage un large consensus face aux actions qu’il conviendrait de mettre en œuvre. Le Québec doit se doter d’un plan ambitieux pour initier et encadrer les changements qui s’imposent dans notre manière d’occuper et de gérer le territoire et les ressources qu’il
contient.
C’est à partir de ce constat que le Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ), la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l’Université du Québec en Outaouais, la Chaire Liber Ero en biologie de conservation de l’Université McGill, le Regroupement national
des conseils régionaux de l'environnement
du Québec et le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) ont initié le projet d’un Livre blanc pour le Sud du Québec. L’objectif de cette démarche est de proposer une vision consensuelle et de faire émerger de grandes orientations sous lesquelles pourront être regroupées des mesures concrètes en faveur du maintien de la biodiversité au sud du 49e parallèle.
Depuis des décennies, le Québec méridional subit des pressions de développement importantes et soutenues, et fait face à de forts arbitrages pour l’utilisation du territoire et des ressources qu’il contient sur un modèle économique de type extractif qui évolue peu. Pourtant, la biodiversité du Québec est principalement concentrée dans cette partie de la province, plus diversifiée que les zones plus au nord. Ces pressions affectent la biodiversité et induisent de profonds changements dans les fonctions et les services
rendus par les écosystèmes dont dépendent de nombreux secteurs économiques, et plus globalement, notre bien-être.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que la biodiversité est généralement reconnue comme la base de toute stratégie d’adaptation face aux changements climatiques. Pour que la société québécoise puisse faire face aux changements environnementaux, qu’ils soient locaux ou plus globaux, il est nécessaire de développer une autre relation à notre patrimoine naturel, en particulier au sud du 49e parallèle du Québec.
La demande sociale grandissante pour la protection de l’environnement témoigne de l’importance de ces enjeux pour de nombreuses parties prenantes, et il se dégage un large consensus face aux actions qu’il conviendrait de mettre en œuvre. Le Québec doit se doter d’un plan ambitieux pour initier et encadrer les changements qui s’imposent dans notre manière d’occuper et de gérer le territoire et les ressources qu’il
contient.
C’est à partir de ce constat que le Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ), la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l’Université du Québec en Outaouais, la Chaire Liber Ero en biologie de conservation de l’Université McGill, le Regroupement national
des conseils régionaux de l'environnement
du Québec et le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) ont initié le projet d’un Livre blanc pour le Sud du Québec. L’objectif de cette démarche est de proposer une vision consensuelle et de faire émerger de grandes orientations sous lesquelles pourront être regroupées des mesures concrètes en faveur du maintien de la biodiversité au sud du 49e parallèle.
Jérôme Dupras, Andrew Gonzalez
La biodiversité des vertébrés : une lueur d'espoir
Des pertes extrêmes dans quelques populations entraînent un déclin apparent des vertébrés dans le monde
 Les populations de vertébrés - des oiseaux aux poissons aux antilopes - ne sont pas, en général, en déclin, en dépit de ce qui a été pensé et dit précédemment.
Une équipe de biologistes, dirigée par l'université McGill, a découvert, dans un article publié récemment dans Nature, que le portrait peignant les populations de vertébrés de toutes sortes en déclin spectaculaire est dû à des anomalies : quelques populations dont le nombre d'individus diminue à un rythme extrême. Une fois que ces valeurs aberrantes sont séparées du reste, une image très différente et bien plus prometteuse de la biodiversité mondiale émerge.
Tout se résume aux mathématiques, à la modélisation et aux différentes approches de calcul des moyennes :
On estime généralement que les populations de vertébrés ont diminué en moyenne de plus de 50 % depuis 1970, sur la base des données historiques de surveillance de la faune sauvage. "Toutefois, compte tenu des méthodes mathématiques utilisées précédemment pour modéliser les populations de vertébrés, cette estimation pourrait résulter de deux scénarios très différents : des déclins systématiques généralisés ou quelques déclins extrêmes", explique Brian Leung, écologiste à McGill, titulaire de la chaire UNESCO du dialogue pour la durabilité et auteur principal de l'étude. Dans cet article, les chercheurs ont abordé la question différemment.
En utilisant un ensemble de données de plus de 14 000 populations de vertébrés du monde entier rassemblées dans la base de données Living Planet, les chercheurs ont identifié environ 1% des populations de vertébrés qui ont subi des déclins extrêmes depuis 1970 (comme les reptiles dans les zones tropicales d'Amérique du Nord, centrale et du Sud, et les oiseaux dans la région indo-pacifique). En tenant compte de ce 1% extrême, les chercheurs ont constaté que les populations de vertébrés restantes ne montraient aucun signe général d’augmentation ou de diminution lorsqu'elles étaient regroupées.
"La variation de cet agrégat mondial est également importante. Certaines populations sont vraiment en difficulté et des régions comme l'Indo-Pacifique affichent des déclins systématiques généralisés. Toutefois, l'image d'un "désert de biodiversité" mondial n'est pas étayée par des preuves", déclare M. Leung. "C'est une bonne chose, car il serait très décourageant que tous nos efforts de conservation au cours des cinq dernières décennies n'aient que peu d'effet".
"Nous avons été surpris par la force de l'effet de ces populations extrêmes dans l'estimation précédente du déclin mondial moyen", ajoute le co-auteur Anna Hargreaves, professeur dans le département de biologie de McGill. "Nos résultats permettent d'identifier les régions qui ont besoin d'une action urgente pour remédier à un déclin généralisé de la biodiversité, mais ils donnent également des raisons d'espérer que nos actions peuvent faire la différence".
Les populations de vertébrés - des oiseaux aux poissons aux antilopes - ne sont pas, en général, en déclin, en dépit de ce qui a été pensé et dit précédemment.
Une équipe de biologistes, dirigée par l'université McGill, a découvert, dans un article publié récemment dans Nature, que le portrait peignant les populations de vertébrés de toutes sortes en déclin spectaculaire est dû à des anomalies : quelques populations dont le nombre d'individus diminue à un rythme extrême. Une fois que ces valeurs aberrantes sont séparées du reste, une image très différente et bien plus prometteuse de la biodiversité mondiale émerge.
Tout se résume aux mathématiques, à la modélisation et aux différentes approches de calcul des moyennes :
On estime généralement que les populations de vertébrés ont diminué en moyenne de plus de 50 % depuis 1970, sur la base des données historiques de surveillance de la faune sauvage. "Toutefois, compte tenu des méthodes mathématiques utilisées précédemment pour modéliser les populations de vertébrés, cette estimation pourrait résulter de deux scénarios très différents : des déclins systématiques généralisés ou quelques déclins extrêmes", explique Brian Leung, écologiste à McGill, titulaire de la chaire UNESCO du dialogue pour la durabilité et auteur principal de l'étude. Dans cet article, les chercheurs ont abordé la question différemment.
En utilisant un ensemble de données de plus de 14 000 populations de vertébrés du monde entier rassemblées dans la base de données Living Planet, les chercheurs ont identifié environ 1% des populations de vertébrés qui ont subi des déclins extrêmes depuis 1970 (comme les reptiles dans les zones tropicales d'Amérique du Nord, centrale et du Sud, et les oiseaux dans la région indo-pacifique). En tenant compte de ce 1% extrême, les chercheurs ont constaté que les populations de vertébrés restantes ne montraient aucun signe général d’augmentation ou de diminution lorsqu'elles étaient regroupées.
"La variation de cet agrégat mondial est également importante. Certaines populations sont vraiment en difficulté et des régions comme l'Indo-Pacifique affichent des déclins systématiques généralisés. Toutefois, l'image d'un "désert de biodiversité" mondial n'est pas étayée par des preuves", déclare M. Leung. "C'est une bonne chose, car il serait très décourageant que tous nos efforts de conservation au cours des cinq dernières décennies n'aient que peu d'effet".
"Nous avons été surpris par la force de l'effet de ces populations extrêmes dans l'estimation précédente du déclin mondial moyen", ajoute le co-auteur Anna Hargreaves, professeur dans le département de biologie de McGill. "Nos résultats permettent d'identifier les régions qui ont besoin d'une action urgente pour remédier à un déclin généralisé de la biodiversité, mais ils donnent également des raisons d'espérer que nos actions peuvent faire la différence".
Funding source: Mcgill
Conservation de la connectivité en eau douce dans le bassin versant de la Yamaska au Québec
 Alex Arkilanian, étudiant en master au laboratoire de Andrew Gonzalez, écrit sa thèse sur la connectivité aquatique. Avec le soutien du MELCC, du MFFP et du MTQ, Alex réalise une évaluation de la connectivité du meunier noir (Catostomus commmersoni) dans bassin versant de la rivière Yamaska. En utilisant une modification de la mesure de la connectivité du réseau, Alex utilise les besoins en matière d'habitat de cette espèce représentative généraliste afin de comprendre sa connectivité fonctionnelle sur de multiples étapes de sa vie, compte tenu des barrières naturelles et anthropiques existantes telles que les barrages, les ponceaux et les chutes d'eau. L'objectif principal de cette évaluation est de déterminer les sites importants pour la conservation de cette espèce en tenant compte à la fois de la connectivité et de la qualité des habitats importants pour les adultes et le frai. Cette évaluation permettra également d'établir un ordre de priorité des barrières anthropiques dans la région qui affectent le plus gravement la connectivité du meunier noir. Cette évaluation jettera les bases d'une évaluation élargie de la connectivité pour la plus grande région des basses terres du Saint-Laurent et pour un portefeuille élargi d'espèces de poissons importantes. La connectivité aquatique a été sous-estimée dans la conservation des eaux douces et cette collaboration avec les ministères provinciaux représente un pas important dans la direction d'une prise en compte plus directe de la connectivité des rivières dans la conservation des poissons d'eau douce.
Alex Arkilanian, étudiant en master au laboratoire de Andrew Gonzalez, écrit sa thèse sur la connectivité aquatique. Avec le soutien du MELCC, du MFFP et du MTQ, Alex réalise une évaluation de la connectivité du meunier noir (Catostomus commmersoni) dans bassin versant de la rivière Yamaska. En utilisant une modification de la mesure de la connectivité du réseau, Alex utilise les besoins en matière d'habitat de cette espèce représentative généraliste afin de comprendre sa connectivité fonctionnelle sur de multiples étapes de sa vie, compte tenu des barrières naturelles et anthropiques existantes telles que les barrages, les ponceaux et les chutes d'eau. L'objectif principal de cette évaluation est de déterminer les sites importants pour la conservation de cette espèce en tenant compte à la fois de la connectivité et de la qualité des habitats importants pour les adultes et le frai. Cette évaluation permettra également d'établir un ordre de priorité des barrières anthropiques dans la région qui affectent le plus gravement la connectivité du meunier noir. Cette évaluation jettera les bases d'une évaluation élargie de la connectivité pour la plus grande région des basses terres du Saint-Laurent et pour un portefeuille élargi d'espèces de poissons importantes. La connectivité aquatique a été sous-estimée dans la conservation des eaux douces et cette collaboration avec les ministères provinciaux représente un pas important dans la direction d'une prise en compte plus directe de la connectivité des rivières dans la conservation des poissons d'eau douce.
Funding source: MELCC, MFFP et MTQ
L'application de méthodes biologiques classiques pour la gestion des espèces exotiques envahissantes causant des impacts environnementaux

Funding source: CBD
Nouvelle étude orchestrée par l’UQAC sur la biodiversité des fonds marins au Canada
 Le professeur en écologie marine de l’UQAC, le Dr Mathieu Cusson, avec ses collègues provenant de 13 institutions canadiennes, vient de publier la plus vaste étude à ce jour sur la biodiversité des fonds marins du Canada. L’étude intitulée « Seafloor biodiversity of Canada's three oceans : Patterns, hotspots and potential drivers » a été publiée très récemment dans la revue Diversity and Distributions, un journal de premier plan dans le domaine. L'étude a évalué la biodiversité marine benthique des trois océans du Canada, du Pacifique à l'Atlantique en passant par l'Arctique.
Le Dr Mathieu Cusson a orchestré les travaux de cette étude qui ont été amorcés dès 2013. Son postdoctorant et premier auteur de l’étude, le Dr Chih-Lin Wei, aujourd’hui professeur d'océanographie à l’Université Nationale de Taiwan, indique : « Il a fallu déployer d'énormes efforts pour compiler et analyser les données de plus de 13 000 échantillons, couvrant plus de 6 000 sites dans les trois océans du Canada. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser ce projet. Il a été difficile de trouver, de formater, de valider et de normaliser les données sur la diversité ». Le Dr Wei ajoute que l’étape la plus cruciale a été de garantir aux fournisseurs de données que leurs données étaient entre de bonnes mains.
« À l'aide d'informations sur le terrain compilées sur plusieurs années par plusieurs laboratoires, cette équipe a utilisé les données de près de 3400 espèces et taxons pour identifier les points chauds de la biodiversité dans les écosystèmes marins canadiens », a déclaré le Dr Ricardo Scrosati, coauteur de l'Université St. Francis Xavier.
L'équipe a utilisé une méthode statistique de pointe en évaluation de la biodiversité. Cette méthode, développée par une statisticienne taïwanaise de renom, la Dre Anne Chao, pour estimer la biodiversité à partir de divers engins d'échantillonnage, puis a utilisé des informations environnementales pour explorer les causes les plus probables des patrons de la biodiversité observée. « Avec près de 60% de taxons de plus que les études précédentes, notre étude montre des points chauds inédits de la biodiversité, entre autres dans l'Arctique canadien, montrant que la vision dominante de la diminution de la diversité avec la latitude n’est pas toujours valide » explique le Dr Mathieu Cusson, leader du projet.
Le Dr Scrosati dit que dans l'ensemble, nos résultats fournissent des informations précieuses qui devraient améliorer, entre autres objectifs, la conception d'aires marines protégées pour préserver notre riche et fascinante biodiversité benthique marine. "Nous sommes heureux de voir l'étude publiée dans cette revue, car elle a un facteur d'impact très élevé, ce qui suggère que l'étude sera largement vue dans la communauté scientifique du monde entier. Ainsi, d'une part, nous espérons attirer des collègues talentueux et les étudiants à poursuivre leurs études sur la biologie marine et, d'autre part, nous espérons voir nos approches appliquées à d'autres parties du monde vers une synthèse mondiale que la science est toujours à la recherche ", a déclaré le Dr Scrosati.
Pourquoi étudier la biodiversité d’habitats qu’on ne voit pas ? Le Dr Mathieu Cusson souligne que la connaissance de la biodiversité des fonds marins aide à comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Aussi, si dans un avenir proche les écosystèmes sont appelés à être modifiés dans leur biodiversité, ces études aiguillonneront les chercheurs sur les conséquences pour leur fonctionnement et, ultimement, pour les services écosystémiques qu’ils nous fournissent.
Le professeur en écologie marine de l’UQAC, le Dr Mathieu Cusson, avec ses collègues provenant de 13 institutions canadiennes, vient de publier la plus vaste étude à ce jour sur la biodiversité des fonds marins du Canada. L’étude intitulée « Seafloor biodiversity of Canada's three oceans : Patterns, hotspots and potential drivers » a été publiée très récemment dans la revue Diversity and Distributions, un journal de premier plan dans le domaine. L'étude a évalué la biodiversité marine benthique des trois océans du Canada, du Pacifique à l'Atlantique en passant par l'Arctique.
Le Dr Mathieu Cusson a orchestré les travaux de cette étude qui ont été amorcés dès 2013. Son postdoctorant et premier auteur de l’étude, le Dr Chih-Lin Wei, aujourd’hui professeur d'océanographie à l’Université Nationale de Taiwan, indique : « Il a fallu déployer d'énormes efforts pour compiler et analyser les données de plus de 13 000 échantillons, couvrant plus de 6 000 sites dans les trois océans du Canada. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser ce projet. Il a été difficile de trouver, de formater, de valider et de normaliser les données sur la diversité ». Le Dr Wei ajoute que l’étape la plus cruciale a été de garantir aux fournisseurs de données que leurs données étaient entre de bonnes mains.
« À l'aide d'informations sur le terrain compilées sur plusieurs années par plusieurs laboratoires, cette équipe a utilisé les données de près de 3400 espèces et taxons pour identifier les points chauds de la biodiversité dans les écosystèmes marins canadiens », a déclaré le Dr Ricardo Scrosati, coauteur de l'Université St. Francis Xavier.
L'équipe a utilisé une méthode statistique de pointe en évaluation de la biodiversité. Cette méthode, développée par une statisticienne taïwanaise de renom, la Dre Anne Chao, pour estimer la biodiversité à partir de divers engins d'échantillonnage, puis a utilisé des informations environnementales pour explorer les causes les plus probables des patrons de la biodiversité observée. « Avec près de 60% de taxons de plus que les études précédentes, notre étude montre des points chauds inédits de la biodiversité, entre autres dans l'Arctique canadien, montrant que la vision dominante de la diminution de la diversité avec la latitude n’est pas toujours valide » explique le Dr Mathieu Cusson, leader du projet.
Le Dr Scrosati dit que dans l'ensemble, nos résultats fournissent des informations précieuses qui devraient améliorer, entre autres objectifs, la conception d'aires marines protégées pour préserver notre riche et fascinante biodiversité benthique marine. "Nous sommes heureux de voir l'étude publiée dans cette revue, car elle a un facteur d'impact très élevé, ce qui suggère que l'étude sera largement vue dans la communauté scientifique du monde entier. Ainsi, d'une part, nous espérons attirer des collègues talentueux et les étudiants à poursuivre leurs études sur la biologie marine et, d'autre part, nous espérons voir nos approches appliquées à d'autres parties du monde vers une synthèse mondiale que la science est toujours à la recherche ", a déclaré le Dr Scrosati.
Pourquoi étudier la biodiversité d’habitats qu’on ne voit pas ? Le Dr Mathieu Cusson souligne que la connaissance de la biodiversité des fonds marins aide à comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Aussi, si dans un avenir proche les écosystèmes sont appelés à être modifiés dans leur biodiversité, ces études aiguillonneront les chercheurs sur les conséquences pour leur fonctionnement et, ultimement, pour les services écosystémiques qu’ils nous fournissent.
Que peut nous apprendre le microbiome intestinal sur la santé des ours polaires ?
 Les ours polaires sont très vulnérables en raison de la fonte de la glace de mer, induite par le changement climatique, car elle réduit leur accès à leur principale source de proie, les phoques annelés, qui doivent se déplacer sur la glace. Par conséquent, certains ours ont modifié leur comportement de recherche de nourriture en utilisant davantage les ressources alimentaires terrestres, comme les carcasses de baleines boréales, les oiseaux de rivage et les œufs d'oiseaux de rivage. Les changements de régime alimentaire peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé d'une espèce et des individus, notamment en modifiant leur microbiome de l'intestin, qui est un assemblage de micro-organismes (principalement des bactéries) connus pour mener à bien de nombreux processus métaboliques et immunitaires importants pour leur organisme hôte. À ce jour, le microbiome intestinal est relativement peu étudié pour de nombreuses populations et espèces sauvages. Notre travail vise à décrire et à comparer de façon préliminaire la composition et la diversité des communautés microbiennes intestinales des ours polaires du sud de la mer de Beaufort et de l'est du Groenland, et à approfondir ces connaissances en évaluant comment les différences dans les régimes alimentaires respectifs de ces sous-populations géographiquement disparates pourraient alternativement façonner leur microbiote intestinal.
Megan Franz est une étudiante en maîtrise de l'Université McGill qui travaille sur ce projet pour sa thèse. Elle est supervisée par le Dr Melissa McKinney, professeure adjointe au département des sciences des ressources naturelles de l'Université McGill et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les changements écologiques et les facteurs de stress environnementaux. Mégan est co-supervisée par le Dr Lyle Whyte, professeur au département des sciences des ressources naturelles de l'Université McGill et titulaire d'une chaire de recherche du Canada en microbiologie polaire. Le projet implique également une collaboration avec Kristin Laidre de l'Université de Washington et Todd Atwood de l'USGS Alaska Science Center.
Les ours polaires sont très vulnérables en raison de la fonte de la glace de mer, induite par le changement climatique, car elle réduit leur accès à leur principale source de proie, les phoques annelés, qui doivent se déplacer sur la glace. Par conséquent, certains ours ont modifié leur comportement de recherche de nourriture en utilisant davantage les ressources alimentaires terrestres, comme les carcasses de baleines boréales, les oiseaux de rivage et les œufs d'oiseaux de rivage. Les changements de régime alimentaire peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé d'une espèce et des individus, notamment en modifiant leur microbiome de l'intestin, qui est un assemblage de micro-organismes (principalement des bactéries) connus pour mener à bien de nombreux processus métaboliques et immunitaires importants pour leur organisme hôte. À ce jour, le microbiome intestinal est relativement peu étudié pour de nombreuses populations et espèces sauvages. Notre travail vise à décrire et à comparer de façon préliminaire la composition et la diversité des communautés microbiennes intestinales des ours polaires du sud de la mer de Beaufort et de l'est du Groenland, et à approfondir ces connaissances en évaluant comment les différences dans les régimes alimentaires respectifs de ces sous-populations géographiquement disparates pourraient alternativement façonner leur microbiote intestinal.
Megan Franz est une étudiante en maîtrise de l'Université McGill qui travaille sur ce projet pour sa thèse. Elle est supervisée par le Dr Melissa McKinney, professeure adjointe au département des sciences des ressources naturelles de l'Université McGill et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les changements écologiques et les facteurs de stress environnementaux. Mégan est co-supervisée par le Dr Lyle Whyte, professeur au département des sciences des ressources naturelles de l'Université McGill et titulaire d'une chaire de recherche du Canada en microbiologie polaire. Le projet implique également une collaboration avec Kristin Laidre de l'Université de Washington et Todd Atwood de l'USGS Alaska Science Center.
Bon appétit! Des contaminants au menu des orques de l’atlantique du nord?
 Les orques sont parmi les animaux les plus contaminés de la planète, accumulant des niveaux élevés de contaminants synthétiques dans leurs tissus. Ces contaminants, notamment les PCB (biphényles polychlorés) et les DDT (dichlorodiphényltrichloroéthanes) sont interdits depuis des décennies, mais ils se dégradent très lentement et s'accumulent fortement dans la chaîne alimentaire, ce qui entraîne une exposition élevée des prédateurs supérieurs. De telles concentrations de contaminants exposent les orques, le principal prédateur des océans, à des risques d'effets endocriniens, reproductifs et immunitaires sur la santé. Il a été démontré que le régime alimentaire est un facteur important dans la variation des contaminants parmi les groupes d'orques. Cependant, le régime alimentaire au sein des groupes d'orques de l'Atlantique Nord et entre eux n'est pas bien compris. Notre projet vise à utiliser des traceurs chimiques à haute résolution du régime alimentaire mesuré à partir d'échantillons de biopsie d'orques de l'Atlantique Nord vivant en liberté afin de mieux comprendre les différents régimes alimentaires des principaux groupes d'orques de l'Atlantique Nord et, par conséquent, de comprendre comment cette variation alimentaire peut entraîner des différences d'exposition aux principales classes de contaminants problématiques pour l'environnement.
Les orques sont parmi les animaux les plus contaminés de la planète, accumulant des niveaux élevés de contaminants synthétiques dans leurs tissus. Ces contaminants, notamment les PCB (biphényles polychlorés) et les DDT (dichlorodiphényltrichloroéthanes) sont interdits depuis des décennies, mais ils se dégradent très lentement et s'accumulent fortement dans la chaîne alimentaire, ce qui entraîne une exposition élevée des prédateurs supérieurs. De telles concentrations de contaminants exposent les orques, le principal prédateur des océans, à des risques d'effets endocriniens, reproductifs et immunitaires sur la santé. Il a été démontré que le régime alimentaire est un facteur important dans la variation des contaminants parmi les groupes d'orques. Cependant, le régime alimentaire au sein des groupes d'orques de l'Atlantique Nord et entre eux n'est pas bien compris. Notre projet vise à utiliser des traceurs chimiques à haute résolution du régime alimentaire mesuré à partir d'échantillons de biopsie d'orques de l'Atlantique Nord vivant en liberté afin de mieux comprendre les différents régimes alimentaires des principaux groupes d'orques de l'Atlantique Nord et, par conséquent, de comprendre comment cette variation alimentaire peut entraîner des différences d'exposition aux principales classes de contaminants problématiques pour l'environnement.
Melissa McKinney, Anaïs REMILI
Une plate-forme de science citoyenne pour la numérisation des spécimens de l'herbier Louis-Marie
 L’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval est le plus grand herbier universitaire canadien. Avec près de 800 000 spécimens entre ses murs, la tâche d’informatisation de cette collection est monumentale. À ce jour, environ 37% des spécimens, surtout des plantes vasculaires, mais aussi des bryophytes et des lichens sont saisis.
Le but d’informatiser la collection de l’Herbier Louis-Marie est de faciliter la gestion et les recherches dans la collection, mais surtout de rendre plus accessible aux chercheurs et au grand public les données de biodiversités de cette collection.
Grâce à la collaboration du Centre de la science de la biodiversité du Québec, l’Herbier a pu mettre en place un portail collaboratif d’informatisation de la collection. Les participants utilisent les images des cartons d’herbier déposées sur le portail pour en décrypter et transcrire les informations essentielles tel le nom de l’espèce, le lieu et la date de récolte, ou le nom de la personne qui a récolté le spécimen. Ces informations d’étiquette, parfois manuscrites, parfois dactylographiées, mais généralement complexes et très différentes les unes des autres, sont généralement mieux interprétées par des personnes, même si des technologies de reconnaissance numérique existent. Nous espérons que ce nouveau portail augmente la cadence d’informatisation de l’Herbier Louis-Marie.
Les données de biodiversité provenant de l’Herbier Louis-Marie sont diffusées sur le site de l’Herbier (herbier.ulaval.ca) et déposées sur plusieurs agrégateurs de données de biodiversité comme Canadensys, GBIF, le consortium des herbiers nord-américains de lichens et de bryophytes et iDigBio.
L’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval est le plus grand herbier universitaire canadien. Avec près de 800 000 spécimens entre ses murs, la tâche d’informatisation de cette collection est monumentale. À ce jour, environ 37% des spécimens, surtout des plantes vasculaires, mais aussi des bryophytes et des lichens sont saisis.
Le but d’informatiser la collection de l’Herbier Louis-Marie est de faciliter la gestion et les recherches dans la collection, mais surtout de rendre plus accessible aux chercheurs et au grand public les données de biodiversités de cette collection.
Grâce à la collaboration du Centre de la science de la biodiversité du Québec, l’Herbier a pu mettre en place un portail collaboratif d’informatisation de la collection. Les participants utilisent les images des cartons d’herbier déposées sur le portail pour en décrypter et transcrire les informations essentielles tel le nom de l’espèce, le lieu et la date de récolte, ou le nom de la personne qui a récolté le spécimen. Ces informations d’étiquette, parfois manuscrites, parfois dactylographiées, mais généralement complexes et très différentes les unes des autres, sont généralement mieux interprétées par des personnes, même si des technologies de reconnaissance numérique existent. Nous espérons que ce nouveau portail augmente la cadence d’informatisation de l’Herbier Louis-Marie.
Les données de biodiversité provenant de l’Herbier Louis-Marie sont diffusées sur le site de l’Herbier (herbier.ulaval.ca) et déposées sur plusieurs agrégateurs de données de biodiversité comme Canadensys, GBIF, le consortium des herbiers nord-américains de lichens et de bryophytes et iDigBio.
Possibilités et limites de l’encadrement juridique de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables au Québec
 Depuis son adoption en 1987, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) a fait l’objet de plusieurs mises à jour, la dernière datant de 2017, et ce, dans le but de résoudre certains problèmes d’application. Dans le cadre du chantier de modernisation du régime d’autorisation en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), de l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) et de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie québécoise de l’eau (SQE), une refonte complète des dispositions de la PPRLPI doit être effectuée, à moyen terme, afin d’y apporter les modifications nécessaires. Celles-ci concernent autant la gestion des zones inondables que des éléments concernant la protection des rives et du littoral, en milieu continental et côtier et possiblement des milieux humides. Une réflexion de fond sur la refonte de cette Politique doit être initiée. L’intégration de nouvelles connaissances et la prise en compte des changements climatiques motivent également cette refonte, de même que les constats sur les problèmes d’application et d’uniformité du cadre normatif minimal par les municipalités. Considérant ces besoins, la Direction de l’agroenvironnement et du milieu hydrique (DAEMH) a décidé de faire appel au Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ), afin d’effectuer une étude critique des mesures réglementaires de l’Union européenne et de quelques pays membres et de leur mise en application. Accédez au rapport ici
Depuis son adoption en 1987, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) a fait l’objet de plusieurs mises à jour, la dernière datant de 2017, et ce, dans le but de résoudre certains problèmes d’application. Dans le cadre du chantier de modernisation du régime d’autorisation en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), de l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) et de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie québécoise de l’eau (SQE), une refonte complète des dispositions de la PPRLPI doit être effectuée, à moyen terme, afin d’y apporter les modifications nécessaires. Celles-ci concernent autant la gestion des zones inondables que des éléments concernant la protection des rives et du littoral, en milieu continental et côtier et possiblement des milieux humides. Une réflexion de fond sur la refonte de cette Politique doit être initiée. L’intégration de nouvelles connaissances et la prise en compte des changements climatiques motivent également cette refonte, de même que les constats sur les problèmes d’application et d’uniformité du cadre normatif minimal par les municipalités. Considérant ces besoins, la Direction de l’agroenvironnement et du milieu hydrique (DAEMH) a décidé de faire appel au Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ), afin d’effectuer une étude critique des mesures réglementaires de l’Union européenne et de quelques pays membres et de leur mise en application. Accédez au rapport ici
Funding source: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, CSBQ, MELCC
À chaque année, les chercheurs et étudiants du CSBQ développent de nouvelles collaborations, co-supervisent de nouveaux étudiants, écrivent des articles dans des journaux prestigieux et explorent de nouveaux sujets de recherche. Le tableau de bord des activités de recherche, de collaboration et de formation du CSBQ est un outil interactif permettant d’explorer de façon intuitive les activités scientifiques et de formation de nos chercheurs et étudiants. Il fournit des représentations graphiques dynamiques de ce qu’est notre réseau aujourd’hui et de son évolution dans le temps. Bonne exploration!




